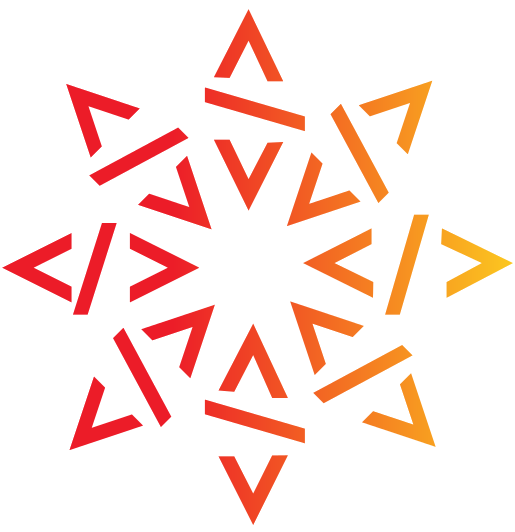Bibliothèques de l’Université Paris-Saclay : une stratégie pour le logiciel
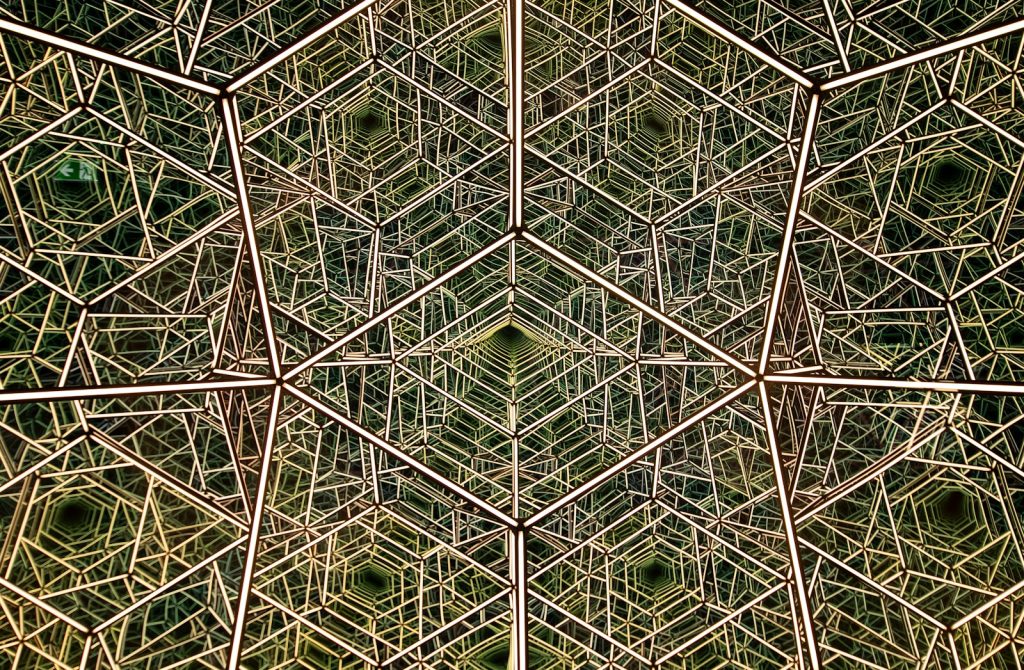
Les bibliothèques font progresser l’enseignement, la recherche et l’apprentissage en fournissant des ressources, en facilitant la découverte et en offrant des conseils spécialisés. Le code source des logiciels devenant de plus en plus central dans la recherche contemporaine, les bibliothèques doivent soutenir les chercheurs et chercheuses qui travaillent avec ces codes. Dans cette série d’entretiens, des professionnels partagent leur approche des logiciels de recherche.
Il faut tout un village pour s’occuper des logiciels ouverts, qu’ils soient libres ou open source. Et au sein de ce village, les Administrateurs des données, algorithmes et codes (Adac) jouent un rôle particulièrement important. Depuis 2023, Cédric Mercier occupe cette fonction à l’Université Paris-Saclay, au sein de la direction des bibliothèques, de l’information et de la science ouverte (DiBISO). En tant qu’ADAC, C. Mercier est chargé de proposer une stratégie institutionnelle sur les données et codes. Avec son équipe, ils aident les chercheurs et chercheuses à gérer leurs données et codes selon les bonnes pratiques et à les partager avec l’ensemble de la communauté scientifique. C. Mercier est par ailleurs pilote de la commission “Signalement données et systèmes d’information” de l’association des directeurs et personnels de direction des bibliothèques universitaires (ADBU).
L’université Paris-Saclay couvre les secteurs des sciences et de l’ingénierie, des sciences de la vie et de la santé, et des sciences humaines et sociales. L’institution rassemble 5 facultés, 3 IUT, 5 grandes écoles, 2 universités membres associés et 7 organismes de recherche. En 2025, l’Université Paris-Saclay a choisi de sponsoriser Software Heritage. Cédric Mercier nous explique la stratégie adoptée pour soutenir le logiciel académique.
En bref:
- L’Université Paris-Saclay va dévoiler sa feuille de route en faveur des logiciels et codes sources dans le courant de l’année 2026.
- L’un des objectifs clés de l’Université Paris-Saclay est de faire fructifier à l’échelle institutionnelle les initiatives existantes, telles que Ipol, revue en modèle diamant hébergée par le Centre Borelli à l’ENS Paris-Saclay.
- L’institution va renforcer les dispositifs d’accompagnement. Les chercheuses et chercheurs seront par exemple sensibilisé·es au dépôt des codes sur HAL, au même niveau que les publications.
Quelles ressources recommanderiez-vous à une personne souhaitant s’initier aux concepts d’ingénierie logicielle ?
En général, nos chercheuses et chercheurs sont demandeurs de réponses pragmatiques. Selon le langage de programmation utilisé, nous leur indiquons les ressources les plus adaptées. Par exemple, dans le cas de Python, PyOpenSci propose de faire de la relecture par des pairs pour des logiciels ouverts. Les ressources fournies par cette organisation sans but lucratif incluent en particulier des guides de paquetage assurant la qualité du code et sa maintenabilité.
Nous conseillons également aux membres de notre communauté d’utiliser une forge logicielle telle que GitHub, dont l’usage est déjà très répandu dans nos laboratoires. Dès les premières années, nous formons nos étudiantes et étudiants à les utiliser.
Comment votre institution facilite-t-elle l’accès aux logiciels de recherche et à leurs dépendances ?
L’Université Paris-Saclay travaille actuellement à une politique commune et formalisée sur les données de la recherche, les codes sources et logiciels, en lien avec sa politique de science ouverte. Cette politique implique l’ensemble des 14 établissements ayant le statut de composantes ou partenaires de l’Université Paris-Saclay. Notre stratégie sur les codes et logiciels devrait être publiée au cours de l’année 2026. En tant qu’administrateur des données, algorithmes et codes, je m’appuie sur les expertises présentes au sein des services support de l’université mais aussi des communautés scientifiques afin de proposer des recommandations sur le sujet : le soutien financier à l’infrastructure Software Heritage en est une. Parmi les mesures en discussion, nous souhaitons par exemple mieux recenser et valoriser ce qui existe déjà à l’échelle de l’Université, comme les forges institutionnelles qui existent sur le périmètre de l’université, et plus globalement encourager et former les doctorant·es et chercheur·ses à partager leurs logiciels.
Quelle est la stratégie de la bibliothèque concernant la gestion des données de recherche et du code source qui y est associé?
Nous cherchons d’abord à mieux connaître les pratiques de nos chercheur·ses en matière de partage de codes, ainsi qu’à cartographier les forges et entrepôts où se trouvent les codes des chercheur·ses affilié·es à l’Université Paris-Saclay. Mais nous souhaitons aussi rapidement mettre nos forces dans l’accompagnement concret des communautés scientifiques.
L’objectif à moyen terme est par exemple de proposer une formation doctorale sur le sujet du partage des codes et logiciels. Nous souhaitons aussi proposer des ateliers sur les software papers, sur le modèle de ce que nous proposons déjà pour faire connaître et valoriser la pratique des data papers.
L’archivage des codes, à travers leur dépôt sur HAL, est également une priorité. Cela fait écho aux missions traditionnelles des bibliothèques universitaires : conserver ce patrimoine scientifique, pour le mettre à disposition des communautés scientifiques. À plus long terme, nous pourrions même envisager un archivage semi-automatisé des codes qui sont déposés sur les serveurs internes de notre mésocentre. L’idée en tant que bibliothèque universitaire et service support est toujours la même : faciliter la vie des chercheur·ses pour répondre à ces enjeux de partage et d’ouverture de la connaissance scientifique.
Quelles synergies identifiez-vous entre Software Heritage et les services existants dans votre institution ?
Les services offerts par Software Heritage rencontrent un très fort écho dans les priorités politiques de l’université. A travers son projet « Springboard » (financements ExcellencES), l’Université Paris-Saclay a fait le choix politique de dédier des moyens au soutien à l’ouverture des codes, via le soutien financier à Software Heritage et au déploiement de moyens humains.
Plus spécifiquement, l’interopérabilité entre HAL et Software Heritage nous intéresse beaucoup, dans la perspective de développer un service d’accompagnement des chercheur·ses de publication de leurs codes dans notre portail HAL. Des initiatives intéressantes fonctionnent déjà au sein de l’Université ; par exemple, IPOL, une revue en modèle diamant hébergée par le Centre Borelli à l’ENS Paris-Saclay, fait déjà le lien entre les codes cités dans les articles et l’archivage vers Software Heritage.
Quels sont les principaux défis que vous rencontrez pour encourager les chercheurs et chercheuses à archiver et partager leur code source ?
Comme sur d’autres aspects de la science ouverte, le principal défi à mon sens est de passer d’une logique d’initiatives individuelles ou communautaires à une politique institutionnelle, en se fixant des objectifs, une méthodologie et des moyens pour y parvenir. Lorsque nous disons cela, l’objectif n’est pas de brider les communautés mais au contraire de s’appuyer sur ce qui se fait déjà et de mettre en valeur ces initiatives, de s’appuyer sur ces exemples moteurs pour embarquer l’ensemble des chercheur·ses et des communautés scientifiques vers le partage des codes. Il faut faire prendre conscience aux équipes de recherche de la valeur des codes qu’ils produisent, car le partage des codes, en plus de répondre pleinement aux objectifs de transparence et de reproductibilité, apporte davantage de notoriété aux résultats publiés.
Selon vous, quelles collaborations faut-il mettre en place ou renforcer pour assurer plus efficacement la pérennité du code source des logiciels de recherche ?
Nous n’avons pas encore, à l’échelle de l’Université Paris-Saclay, la même maturité en termes d’archivage des codes que sur d’autres objets tels que les publications ou les données de la recherche. Mais il me semble que lorsque l’on parle de collaborations, cela peut s’entendre à plusieurs niveaux : d’abord entre les équipes de recherche et les services centraux de l’Université (dont la bibliothèque universitaire fait partie), où nous devons nécessairement instaurer une collaboration. Les chercheur·ses nous font part de leurs besoins et, en retour, nous essayons d’y répondre tout en les sensibilisant aux objectifs de l’université en termes de partage et d’ouverture des codes et logiciels. Ensuite, une collaboration plus institutionnelle, entre l’université et des dispositifs tels que Software Heritage : le soutien financier apparaît comme naturel, lorsque de l’autre côté, nous bénéficions déjà des infrastructures numériques et de l’expertise acquise sur le sujet. Les éditeurs ont également un rôle à jouer dans l’encouragement à publier du code, notamment en demandant un « code availability statement », afin d’indiquer où le code lié à un article a été archivé.
Quelles nouvelles expertises cherchez-vous à développer au sein de vos équipes ?
Aujourd’hui, nous demandons aux personnels chargés d’accompagner les communautés au partage des données de la recherche d’être progressivement capables d’accompagner également le partage de codes et logiciels. C’est un enjeu d’évolution notamment pour notre Atelier de la donnée « DatASaclay ». Concrètement, nous souhaitons développer à terme les expertises nécessaires pour aider les chercheur·ses à rédiger des software papers ou des plans de gestion de logiciels, sur le modèle des plans de gestion de données. Nous essayons de développer ces nouvelles compétences au sein de nos équipes en nous appuyant sur les compétences déjà acquises en matière de référencement, d’archivage et de partage des publications et des données, mais aussi à travers la veille et la formation qui font partie intégrante de nos métiers. Nous suivons par exemple de près le lancement des Open Source Program Offices (OSPOs), comme ce qui vient d’être fait à l’Université Grenoble Alpes. En janvier 2026, nous recruterons un·e ingénieur·e dont la mission sera spécifiquement dédiée à l’accompagnement de la communauté scientifique d’informatique, où les enjeux de partage de codes sont naturellement très prégnants.
À venir
- Découvrez la suite de notre prochaine série d’entretiens avec des bibliothécaires.
- (Re)découvrir les entretiens précédents
- Devenir un sponsor de Software Heritage
- Consultez les ressources sur la science ouverte produites par Software Heritage
- Mettez en oeuvre le dépôt de logiciels dans HAL:
- Guide pour les déposant·es
- Guide pour les modérateur·rices
- Série de vidéos pour déposer facilement son logiciel
- Ressources pour les formateur·rices: se former à accompagner au dépôt logiciel.
- Les demandes de formation (modération, formation de formateur·rices) les sont à adresser au Centre pour la Communication Scientifique Directe :
- sebastien.mazzarese/@/ccsd.cnrs.fr
- Promouvoir le dépôt de logiciel auprès des directions des équipes de recherche
- Lire la feuille de route “Science ouverte” de Software Heritage
- Di Cosmo, R., Granger, S., Hinsen, K., Jullien, N., Le Berre, D., Louvet, V., Maumet, C., Maurice, C., Monat, R., & Rougier, N. P. (2025). Stop treating code like an afterthought: Record, share and value it. Nature, 646(8084), 284–286. https://doi.org/10.1038/d41586-025-03196-0